Aperçu de la mission des Balkans
Entre 1992 et 2004, plus de 40 000 membres des Forces armées canadiennes ont servi dans les Balkans dans le cadre des efforts internationaux de maintien de la paix et de stabilisation. Déployés en Bosnie, en Croatie, au Kosovo et dans les régions avoisinantes, leur mission consistait à rétablir l'ordre, de protéger les civils et de soutenir la reconstruction de communautés déchirées par la guerre en période de conflit profond et de crise humanitaire.
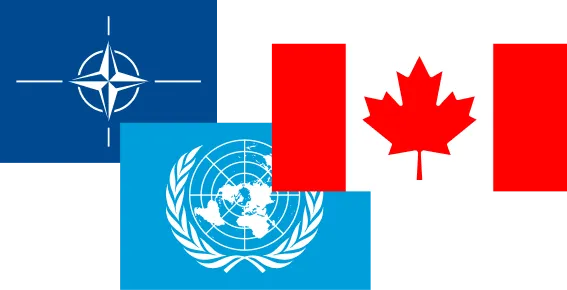

Yougoslavie 1918-1980
La Yougoslavie (Pays des Slaves du Sud) était un pays des Balkans qui a existé de 1918 à 1992. Elle a été créée après la Première Guerre mondiale sous le nom du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Cette fusion faisait suite à à l’intégration du Royaume de Serbie avec l'État provisoire des Slovènes, Croates et Serbes, et constituait la première union des peuples slaves du Sud en tant qu'État souverain. Cette fusion est venue après des siècles de domination étrangère sur la région sous l'Empire ottoman et la monarchie des Habsbourg.

Peinture, Mère de la Yougoslavie.
Sous le règne de la Maison de Karađorđević, le royaume obtint une reconnaissance internationale le 13 juillet 1922, lors de la Conférence des ambassadeurs à Paris, et fut rebaptisé Royaume de Yougoslavie le 3 octobre 1929. Le roi Pierre Ier fut le premier souverain du pays. À la mort de son père en 1921, le roi Alexandre Ier dirigea le pays pendant une longue période de crise politique qui culmina avec la dictature du 6 janvier et, finalement, son assassinat en 1934. Le prince Paul dirigea l'État en tant que prince régent jusqu'à ce que le fils d'Alexandre, Pierre II, soit déclaré majeur, ce qui survint après le coup d'État yougoslave en mars 1941. Alexandre Ier fut le plus long règne des trois monarques yougoslaves.

Panzer IV allemand de la 11e division blindée avançant en Yougoslavie depuis la Bulgarie au sein de la 12e armée en avril 1941. (Bundesarchiv_Bild_101I-770-0280-20)
Le royaume fut envahi et occupé par les puissances de l'Axe en avril 1941, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie. Avec le soutien des Alliés, la résistance partisane menée par les communistes proclama la Yougoslavie fédérale démocratique en novembre 1943. En 1944, le roi Pierre II, alors en exil, reconnut le Conseil antifasciste pour la libération nationale de la Yougoslavie comme gouvernement légitime. En novembre 1945, après la fin de la guerre, le conseil de régence nommé par le roi convoqua des élections parlementaires qui établirent l'Assemblée constituante de Yougoslavie. L'Assemblée constituante proclama la Yougoslavie, république fédérale le 29 novembre 1945, abolissant ainsi le régime monarchique. Ceci marqua le début d'un règne incontesté du parti communiste sur le pays qui dura quatre décennies. La République populaire fédérale de Yougoslavie, nouvellement proclamée, acquit les territoires d'Istrie, de Rijeka et de Zadar de l'Italie.

Le chef des partisans Josip Broz Tito a dirigé le pays de 1944 jusqu'à sa mort en 1980, d'abord comme Premier ministre, puis comme président. En 1963, le pays a été rebaptisé pour la dernière fois République fédérative socialiste de Yougoslavie (RFSY).
Les six républiques constituant la RFSY étaient les républiques socialistes de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine, du Monténégro, de Serbie et de Slovénie. La Serbie comprenait deux provinces autonomes socialistes, le Kosovo et la Voïvodine. Après l'adoption de la Constitution yougoslave de 1974, ces provinces étaient largement sur un pied d'égalité avec les autres membres de la fédération.
Le maréchal Josip Broz Tito a été nommé président à vie le 7 avril 1963. À la tête du gouvernement yougoslave se trouvaient le président (Tito), le Premier ministre fédéral et le Parlement fédéral (une présidence collégiale a été formée après la mort de Tito en 1980).
1980-1992
Après la mort de Tito, le 4 mai 1980, les tensions ethniques s'intensifièrent en Yougoslavie. Une crise économique et politique éclata, entraînant la montée du nationalisme et des conflits ethniques. Le système décisionnel fut paralysé, d'autant plus désespéré que les conflits d'intérêts devenaient irréconciliables. Cela conduisit à l'éclatement de la Yougoslavie le long des frontières de ses républiques, lors des révolutions de 1989. La division en cinq pays distincts déclencha les guerres yougoslaves.

Après la mort de Tito, le dirigeant communiste serbe Slobodan Milošević a commencé à gravir les échelons du pouvoir serbe. En janvier 1990, le 14e Congrès extraordinaire de la Ligue des communistes de Yougoslavie a été convoqué. Les délégations serbe et slovène ont débattu de l'avenir de la Ligue et de la Yougoslavie. La délégation serbe, menée par Milošević, a insisté sur le principe « une personne, une voix » qui donnerait plus de pouvoir à la population majoritaire, les Serbes. De son côté, la délégation slovène, soutenue par les Croates, a cherché à réformer la Yougoslavie en déléguant davantage de pouvoirs aux républiques, mais sa proposition a été rejetée. En conséquence, les délégations slovène et croate ont quitté le Congrès et le Parti communiste yougoslave a été dissous.
La crise constitutionnelle qui s'ensuivit inévitablement provoqua une montée du nationalisme dans toutes les républiques : la Slovénie et la Croatie exprimèrent leurs revendications pour un relâchement des liens au sein de la fédération. Après la chute du communisme en Europe de l'Est, chacune de ces républiques organisa des élections multipartites en 1990. La Slovénie et la Croatie organisèrent ces élections en avril, leurs partis communistes ayant choisi de céder le pouvoir pacifiquement. D'autres républiques yougoslaves, notamment la Serbie, étaient plus ou moins insatisfaites de la démocratisation de deux d'entre elles et proposèrent des sanctions différentes (par exemple, une « taxe douanière » serbe sur les produits slovènes) à leur encontre. Cependant, au fil de l'année, les partis communistes des autres républiques comprirent l'inéluctabilité du processus de démocratisation. [Citation nécessaire]. En décembre, dernier membre de la fédération, la Serbie organisa des élections parlementaires confirmant le pouvoir des anciens communistes.
La Slovénie et la Croatie ont élu des gouvernements favorables à une plus grande autonomie des républiques (sous Milan Kučan et Franjo Tuđman, respectivement). La Serbie et le Monténégro ont élu des candidats favorables à l'unité yougoslave. [Citation nécessaire]. La quête d'indépendance des Croates a conduit d'importantes communautés serbes de Croatie à se rebeller et à tenter de se séparer de la république croate. Les Serbes de Croatie n'accepteraient pas le statut de minorité nationale dans une Croatie souveraine, car ils seraient rétrogradés au rang de nation constitutive. (Wikipédia).
1990, Les guerres yougoslaves

La guerre éclata lorsque les nouveaux régimes tentèrent de remplacer les forces civiles et militaires yougoslaves par des forces sécessionnistes. Lorsqu'en août 1990, la Croatie tenta de remplacer par la force la police dans la Krajina croate peuplée de Serbes, la population chercha d'abord refuge dans les casernes de l'armée yougoslave, tandis que l'armée restait passive. Les civils organisèrent alors une résistance armée. Ces conflits armés entre les forces armées croates (« police ») et les civils marquèrent le début de la guerre de Yougoslavie qui enflamma la région. De même, la tentative de remplacer la police des frontières yougoslave par des forces de police slovènes provoqua des conflits armés régionaux qui se sont terminés par un nombre minimal de victimes.
Une tentative similaire en Bosnie-Herzégovine a conduit à une guerre qui a duré plus de trois ans. Tous ces conflits ont abouti à l'émigration quasi totale des Serbes des trois régions, au déplacement massif des populations de Bosnie-Herzégovine et à la création de trois nouveaux États indépendants. La séparation de la Macédoine s'est faite pacifiquement, bien que l'armée yougoslave ait occupé le sommet de la montagne Straža, sur le sol macédonien.
Les soulèvements serbes en Croatie ont débuté en août 1990 par le blocage des routes reliant la côte dalmate à l'intérieur des terres, près d'un an avant que les dirigeants croates ne prennent la moindre initiative en faveur de l'indépendance. Ces soulèvements ont été soutenus plus ou moins discrètement par l'armée fédérale (JNA), dominée par les Serbes. Les Serbes de Croatie ont proclamé des « régions autonomes serbes, » qui ont ensuite été réunies au sein de la République serbe de Krajina. L'armée fédérale a tenté de désarmer les forces de défense territoriale de Slovénie (les républiques disposaient de leurs propres forces de défense locales, similaires à la Garde nationale) en 1990, mais sans succès. Malgré cela, la Slovénie a commencé à importer clandestinement des armes pour reconstituer ses forces armées.
La Croatie s'est également lancée dans l'importation illégale d'armes (suite au désarmement des forces armées des républiques par l'armée fédérale), principalement en provenance de la Hongrie. Ces activités étaient sous surveillance constante et ont donné lieu à la vidéo d'une réunion secrète entre le ministre croate de la Défense, Martin Špegelj, et deux hommes non identifiés. La vidéo, filmée par le contre-espionnage yougoslave (KOS, Kontra-obavještajna služba), montrait Špegel annonçant la guerre contre l'armée et donnant des instructions sur la contrebande d'armes, ainsi que sur les méthodes à adopter face aux officiers de l'armée yougoslave stationnés dans les villes croates. La Serbie et l'Armée populaire yougoslave (JNA) ont utilisé cette découverte du réarmement croate à des fins de propagande. Des coups de feu ont également été tirés depuis des bases militaires à travers la Croatie. Ailleurs, la tension était vive. Le même mois, les chefs de l'armée ont rencontré la présidence yougoslave pour tenter de l'amener à déclarer l'état d'urgence qui permettrait à l'armée de prendre le contrôle du pays. L'armée était alors considérée comme un bras armé du gouvernement serbe, si bien que les autres républiques craignaient une domination serbe totale de l'Union. Les représentants de la Serbie, du Monténégro, du Kosovo et de la Voïvodine votèrent pour la décision, tandis que toutes les autres républiques, la Croatie, la Slovénie, la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine, votèrent contre. Ce rapprochement permit de retarder l'escalade du conflit, mais pas pour longtemps.
Suite aux premières élections multipartites, à l'automne 1990, les républiques de Slovénie et de Croatie proposèrent de transformer la Yougoslavie en une confédération souple de six républiques. Cette proposition garantissait le droit à l'autodétermination des républiques. Cependant, Milošević rejeta toutes ces propositions, arguant que, comme les Slovènes et les Croates, les Serbes (et notamment les Serbes de Croatie) devaient également bénéficier du même droit.
Le 9 mars 1991, des manifestations furent organisées contre Slobodan Milošević à Belgrade, mais la police et l'armée furent déployées dans les rues pour rétablir l'ordre, faisant deux morts. Fin mars 1991, l'incident des lacs de Plitvice fut l'un des premiers signes d'une guerre ouverte en Croatie. L'Armée populaire yougoslave (ANY), dont les officiers supérieurs étaient principalement d'origine serbe, conserva une impression de neutralité, mais au fil du temps, elle s'impliqua de plus en plus dans la politique de l'État.
Le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie sont devenues les premières républiques à déclarer leur indépendance de la Yougoslavie. Les douaniers fédéraux en poste aux frontières avec l'Italie, l'Autriche et la Hongrie ont simplement changé d'uniforme, la plupart étant des Slovènes locaux. Le lendemain (le 26 juin), le Conseil exécutif fédéral a expressément ordonné à l'armée de prendre le contrôle des « frontières internationalement reconnues », ce qui a déclenché la guerre des Dix Jours. Alors que la Slovénie et la Croatie luttaient pour leur indépendance, les forces serbes et croates se livraient à une rivalité violente et périlleuse.
Les forces de l'Armée populaire yougoslave, basées dans des casernes en Slovénie et en Croatie, tentèrent d'accomplir la mission dans les 48 heures qui suivirent. Cependant, en raison de fausses informations transmises aux conscrits de l'armée yougoslave, selon lesquelles la Fédération était attaquée par des forces étrangères et du fait que la majorité d'entre eux ne souhaitaient pas s'engager dans une guerre sur le terrain où ils effectuaient leur service militaire, les forces de défense territoriale slovènes reprirent la plupart des positions en quelques jours, avec un minimum de pertes humaines de part et d'autre.
Il existait cependant des preuves d'un crime de guerre présumé. La chaîne de télévision autrichienne ORF a diffusé des images de trois soldats de l'armée yougoslave se rendant aux forces de défense territoriale lorsque des coups de feu ont été entendus et que les troupes ont été vues s'effondrer. Personne n'a été tué dans l'incident, mais de nombreux cas de destruction de biens et de vies civiles par l'Armée populaire yougoslave ont été recensés, notamment des maisons et une église. Un aéroport civil, ainsi qu'un hangar et les avions à l'intérieur du hangar, ont été bombardés ; des chauffeurs routiers sur la route de Ljubljana à Zagreb et des journalistes autrichiens à l'aéroport de Ljubljana ont été tués.
Un cessez-le-feu fut finalement conclu. Conformément à l'accord de Brioni, reconnu par les représentants de toutes les républiques, la communauté internationale fit pression sur la Slovénie et la Croatie pour qu'elles imposent un moratoire de trois mois sur leur indépendance. Durant ces trois mois, l'armée yougoslave acheva son retrait de Slovénie, mais en Croatie, une guerre sanglante éclata à l'automne 1991. Les Serbes de souche, qui avaient créé leur propre État, la République serbe de Krajina, dans des régions fortement peuplées par les Serbes, résistèrent aux forces de police de la République de Croatie qui tentaient de ramener cette région séparatiste sous juridiction croate. Dans certains endroits stratégiques, l'armée yougoslave servit de zone tampon ; dans la plupart des autres, elle protégea ou aida les Serbes en leur fournissant des ressources, voire des effectifs, dans leur confrontation avec la nouvelle armée croate et ses forces de police. En septembre 1991, la République de Macédoine déclara également son indépendance, devenant la seule ancienne république à accéder à la souveraineté sans résistance des autorités yougoslaves basées à Belgrade. 500 soldats américains furent alors déployés sous la bannière de l'ONU pour surveiller les frontières nord de la Macédoine avec la République de Serbie. Le premier président de la Macédoine, Kiro Gligorov, entretenait de bonnes relations avec Belgrade et les autres républiques séparatistes, et il n'y a eu jusqu'à présent aucun problème entre les polices des frontières macédoniennes et serbes, même si de petites zones du Kosovo et la vallée de Preševo complètent la partie nord de la région historique connue sous le nom de Macédoine (partie de Prohor Pčinjski), ce qui, sans cela, créerait un conflit frontalier si jamais le nationalisme macédonien devait refaire surface (voir Organisation révolutionnaire macédonienne interne). Et ce, malgré le fait que l'armée yougoslave ait refusé d'abandonner son infrastructure militaire au sommet de la montagne Straža jusqu'en 2000.
À la suite du conflit, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution 721, le 27 novembre 1991, qui a ouvert la voie à la mise en place d'opérations de maintien de la paix en Yougoslavie.
.webp)
En Bosnie-Herzégovine, en novembre 1991, les Serbes de Bosnie organisèrent un référendum qui aboutit à une large majorité à la formation d'une république serbe à l'intérieur des frontières de la Bosnie-Herzégovine et au maintien d'un État commun avec la Serbie-et-Monténégro. Le 9 janvier 1992, l'assemblée autoproclamée des Serbes de Bosnie proclama une « République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine » distincte. Le référendum et la création des RAS furent déclarés inconstitutionnels par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine, illégaux et invalides. En février-mars 1992, le gouvernement organisa un référendum national sur l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Ce référendum fut à son tour déclaré contraire à la Constitution de Bosnie-Herzégovine et à la Constitution fédérale par la Cour constitutionnelle fédérale de Belgrade et le nouveau gouvernement des Serbes de Bosnie.
Le référendum fut largement boycotté par les Serbes de Bosnie. La Cour fédérale de Belgrade ne se prononça pas sur la question du référendum des Serbes de Bosnie. Le taux de participation se situa entre 64 et 67 %, et 98 % des électeurs se prononcèrent pour l'indépendance. La signification exacte de la majorité des deux tiers n'était pas claire et la question de savoir si, elle était respectée. Le gouvernement de la république proclama son indépendance le 5 avril, et les Serbes proclamèrent immédiatement l'indépendance de la Republika Srpska. La guerre en Bosnie éclata peu après.
Opérations canadiennes dans les Balkans, de 1991 à nos jours

Les Canadiens ont servi dans des missions de la Communauté européenne, des Nations Unies (ONU) et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, au Monténégro et en Macédoine. Ces nouveaux pays sont nés des cendres de l'ancienne Yougoslavie. Dès 1991, des dizaines de milliers de membres des Forces armées canadiennes (FAC) ont rejoint ces missions dans la région des Balkans, en Europe du Sud-Est. Ils ont œuvré au rétablissement de la paix et de la sécurité pour les populations de cette région. L'éclatement des combats a suscité une réaction internationale. La Slovénie et les forces militaires du reste de la Yougoslavie ont mené une brève guerre à l'été 1991. Pour contribuer au respect du cessez-le-feu, la Mission de surveillance de la Communauté européenne a été mise sur pied. Des officiers des FAC ont rejoint cet effort multinational de soutien de la paix en septembre 1991.
La Force de protection des Nations Unies (FORPRONU)

Des combats éclatèrent en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Début 1992, la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) fut créée. Elle protégea les civils dans trois « zones protégées par l'ONU » en Croatie et en empêcha l'entrée des autres forces militaires. À la fin du mandat initial de la FORPRONU en 1995, sa mission s'était étendue à l'ensemble de la région. Des Casques bleus de dizaines de pays, dont le Canada, participèrent à cet effort.
Le Canada a joué un rôle important dans les efforts de la FORPRONU. Des soldats canadiens se sont rendus dans les Balkans comme force de maintien de la paix. Mais ils ont vite constaté qu'il y avait souvent très peu de « paix » à « maintenir ». De nombreux membres des FAC ont essuyé des tirs nourris, notamment dans la poche de Medak, en Croatie. C'est durant cette période que les troupes canadiennes ont connu leurs plus violents combats depuis la guerre de Corée.
Au printemps 1992, les combats s'intensifièrent en Bosnie-Herzégovine. La FORPRONU déploya des troupes dans la région. Son objectif était de venir en aide aux civils pris au piège par les combats et d'acheminer de l'aide humanitaire. Une partie importante de l'opération consistait à ouvrir l'aéroport de Sarajevo afin de permettre l'acheminement aérien des fournitures. En juillet 1992, alors que les Casques bleus canadiens protégeaient l'aéroport et escortaient les convois de secours, ils essuyèrent souvent des tirs.
Le major-général canadien Lewis MacKenzie commandait les forces des Nations Unies (ONU) dans le secteur de Sarajevo. Il a souvent fait la une des journaux internationaux, s'efforçant de sensibiliser le monde à la dure réalité de la situation. En fin de compte, nos efforts de maintien de la paix ont permis de maintenir l'aide extérieure vitale.
Des milliers de membres des Forces armées canadiennes (FAC) ont pris part aux efforts de la FORPRONU. Presque tous les bataillons d'infanterie et régiments blindés canadiens ont passé du temps dans les Balkans. Les membres des FAC ont joué de nombreux autres rôles importants au sein de la FORPRONU. Nos militaires ont fourni des services de génie militaire, de déminage, de soutien logistique, de guerre électronique et de contrôle aérien. Des navires de guerre canadiens ont patrouillé la mer Adriatique pour aider l'ONU à bloquer les livraisons d'armes dans la région. Des avions canadiens ont fait respecter les zones d'exclusion aérienne de l'ONU et ont empêché les belligérants d'acheter des armes.
Durant toute cette période, les Casques bleus canadiens ont apporté une aide précieuse aux populations locales de diverses manières. Par exemple, ils ont protégé les convois d'aide humanitaire et les patients des hôpitaux. Ils ont également offert bénévolement temps et argent pour donner des fournitures scolaires et réparer des bâtiments endommagés.
La poche de Medak
(15 — 16 septembre 1993)

Chargées de protéger les civils en Croatie, les Forces armées canadiennes (FAC) ont été la cible de tirs nourris.
Offensive croate
En septembre 1993, les forces croates et serbes se sont affrontées dans la région de Lika, au sud de la Croatie. Le 9 septembre, les troupes croates ont attaqué près de la ville de Medak et repoussé la ligne serbe. Cela a créé la « poche de Medak », un territoire sous contrôle croate peuplé de Serbes.
Négocier un cessez-le-feu
La pression politique et publique a contraint les forces croates à accepter un cessez-le-feu avec les Serbes. Les termes de l'accord prévoyaient que les deux forces retournent à leurs positions initiales et quittent la poche de Medak le 15 septembre. Il incombait aux troupes de soutien à la paix de l'ONU de faire respecter ce fragile accord.
Des soldats canadiens au milieu

Le 2e Bataillon du « Princess Patricia's Canadian Light Infantry » était le meilleur contingent des Nations Unies disponible pour cette mission. Appuyé par deux compagnies de soldats français, il devait pénétrer dans la poche de Medak et s'assurer du départ des deux camps. Il devait également aider les réfugiés à rentrer chez eux dans la région.
Le 15 septembre, alors que les troupes canadiennes et françaises avançaient, les forces croates commencèrent à tirer sur elles. Les troupes de l'ONU se retranchèrent et créèrent une ligne défensive. L'artillerie, les fusils et les mitrailleuses croates fusèrent. Les Canadiens ripostèrent pour se défendre. Ils repoussèrent les forces croates au cours des 15 heures suivantes. Ce fut l'action la plus violente que les troupes canadiennes aient connue depuis la guerre de Corée.
Une confrontation avec le monde qui nous regarde

Le lieutenant-colonel James Calvin, commandant canadien, négocia avec les forces croates. Celles-ci acceptèrent de se retirer à midi, le 16 septembre. Mais lorsque les troupes de l'ONU tentèrent de pénétrer dans la poche de Medak, elles se heurtèrent encore à un barrage routier et à un champ de mines croates.
Des éléments suggéraient que nos troupes étaient tenues à l'écart afin que les Croates puissent y mener un nettoyage ethnique. Le lieutenant-colonel Calvin tint donc une conférence de presse avec des journalistes internationaux présents sur place. Il déclara que les forces croates ne respectaient pas leur part du cessez-le-feu et dissimulaient leurs attaques contre les civils serbes. Les forces croates finirent par reculer et laissèrent passer les troupes de l'ONU.
Les conséquences dans la poche de Medak
Les forces de l'ONU purent enfin pénétrer dans la poche de Medak. Elles découvrirent des preuves de violences atroces contre la population locale. De nombreux villageois serbes étaient morts, victimes de ce qui semblait être un nettoyage ethnique perpétré par les troupes croates. Les Canadiens consignèrent en détail ce qu'ils trouvèrent dans les villages. Leurs archives furent intégrées aux enquêtes ultérieures sur les crimes de guerre. Quatre soldats canadiens furent blessés lors des combats dans la poche de Medak. Mais les forces de l'ONU persévèrent. Elles forcèrent les Croates à mettre fin à leur nettoyage ethnique et évitèrent ainsi d'autres morts civiles.
Une mention spéciale

En 2002, la gouverneure générale Adrienne Clarkson a rendu hommage aux Canadiens qui ont combattu dans la poche de Medak. Elle a décerné la Mention élogieuse du commandant en chef à l'intention des unités au 2e Bataillon du « Princess Patricia's Canadian Light Infantry. » Cette distinction est décernée à toute unité ou sous-unité « ayant accompli un acte ou une activité extraordinaire d'une rare envergure dans des circonstances extrêmement dangereuses ».
Les efforts de l'OTAN dans les Balkans
Mars 1999 — avril 2004

Les avions de combat des Forces armées canadiennes (FAC) ont participé aux frappes aériennes de l'OTAN au Kosovo. Ils ont connu certaines de leurs interventions les plus intenses depuis la guerre de Corée.
L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord prend le relais
Le mandat initial de la FORPRONU a pris fin au printemps 1995. Trois forces multinationales différentes ont repris ses missions dans les Balkans : deux en Macédoine et en Croatie. Une FORPRONU restructurée a poursuivi ses opérations en Bosnie-Herzégovine. En décembre, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) avait pris en charge la plupart des missions de soutien de la paix dans la région. Les membres des FAC ont continué à servir dans les Balkans, mais dans le cadre d'une nouvelle mission de l'OTAN.
Force de mise en œuvre de l'OTAN

L'Accord de paix de « Dayton » de décembre 1995 a défini les conditions de la fin des combats en Bosnie-Herzégovine. Une Force multinationale de mise en œuvre de la paix patrouillait le long des lignes de cessez-le-feu et à d'autres frontières. Elle contribuait à la sécurité des citoyens, soutenait les forces de police locales et surveillait les élections. La Force de mise en œuvre a également aidé les réfugiés à rentrer chez eux et à reconstruire l'économie.
Plus de 1 000 membres des FAC ont servi au sein de la Force de mise en œuvre dans de nombreux rôles, notamment au sein d'un groupe de commandement, d'un escadron de reconnaissance, d'une compagnie d'infanterie mécanisée, d'un escadron du génie et d'éléments de commandement et de soutien.
Force de stabilisation de l'OTAN

La Force de stabilisation constituait la phase suivante des efforts de soutien de la paix de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine. Formée en décembre 1996, elle voyait des troupes multinationales de soutien de la paix patrouiller le pays. Elle a contribué à instaurer une paix durable dans ce pays déchiré par la guerre. Son objectif était de contribuer à l'instauration d'une nation démocratique capable de soutenir le processus de paix sans l'aide des forces multinationales de soutien de la paix. Plus que 1 200 membres des FAC serviraient au sein de la Force de stabilisation.
Troubles au Kosovo
En 1998, les combats ont éclaté entre l'armée serbe et les Albanais du Kosovo. Malgré les tentatives de l'OTAN pour imposer la paix, les violences ont continué. L'armée serbe a attaqué à plusieurs reprises les albanais civils du Kosovo. L'OTAN a menacé d'intervenir militairement contre les Serbes, si un cessez-le-feu durable n'était pas signé. Suite à l'échec des négociations, les forces de l'OTAN ont lancé une campagne aérienne.

Opération Force alliée

Des « CF-18 Hornet » canadiens décollent de leur base italienne pour frapper des cibles au Kosovo en 1999, représentées dans le tableau « Balkan Strikers » de Robert Bailey.
« L'opération Force alliée » était le nom de code donné à la campagne de bombardement de l'OTAN au Kosovo. Son objectif était de chasser l'armée serbe du Kosovo. En mars 1999, le Canada a déployé six CF-18, un nombre qui est passé à 18 à la fin de la mission. Les avions de combat canadiens ont représenté 10 % des missions effectuées au Kosovo. C'était la première fois que des pilotes canadiens effectuaient des missions de combat depuis la guerre de Corée.
Cessez-le-feu
La campagne de bombardements de l'OTAN a causé d'importants dégâts, et a eu de lourdes conséquences sur les forces serbes au Kosovo. Pour mettre fin aux bombardements, l'OTAN a déployé des forces terrestres au Kosovo et en Macédoine voisine. En juin, les forces serbes ont accepté un cessez-le-feu et la Force de l'OTAN pour le Kosovo est intervenue.
Le rôle du Canada au sein de la Force de paix au Kosovo
Le Canada a initialement affecté environ 800 soldats de soutien de la paix à la Force de paix au Kosovo, puis en a rapidement ajouté 500. Les Canadiens ont contribué au maintien d'une paix fragile, protégé les civils et fourni un soutien en matière de reconnaissance. Les FAC ont déployé un escadron de reconnaissance blindée, un escadron d'hélicoptères tactiques, un escadron du génie, un groupement tactique d'infanterie et des éléments de commandement et de soutien logistique.
Ils ont dirigé des patrouilles et surveillé les activités. Nos soldats ont également mené de nombreux projets d'aide humanitaire au Kosovo. Ils ont reconstruit des écoles et des installations médicales endommagées. Ils ont installé de petits ponts et aménagé des terrains de jeux pour les enfants de la région.
En décembre 1999, les premiers Canadiens à servir dans la Force de paix au Kosovo ont quitté le pays. En juin 2000, la plupart des militaires canadiens avaient quitté le pays.
Sur la voie de la paix
En décembre 2003, la situation en Bosnie s'était améliorée. L'OTAN a réduit la taille de la Force de paix au Kosovo, et le contingent canadien est tombé à environ 650 personnes en avril 2004. La Force de l'Union européenne a dirigé les troupes multinationales de soutien de la paix à la fin de 2004. À mesure que la mission prenait cette nouvelle forme, le nombre de membres des FAC au pays est tombé à moins de 85.
Une équipe de liaison et d'observation a dirigé le rôle du Canada auprès de la Force de l'Union européenne. Ces troupes sont restées en contact étroit avec les autorités locales, les services de police, les dirigeants communautaires et les unités de l'armée. Elles ont contribué à l'instauration d'une société pacifique, à la collecte d'armes illégales et à la lutte contre la contrebande. Une paix durable s'étant instaurée, les FAC ont retiré leurs dernières troupes de Bosnie-Herzégovine en 2007.
Une poignée de membres des FAC servent encore aujourd'hui dans les Balkans. La région s'est rétablie après les guerres civiles dévastatrices qui ont ravagé l'ex-Yougoslavie au début des années 1990. Près de 40 000 Casques bleus canadiens y ont servi au fil des ans. Ils ont joué un rôle majeur dans l'instauration de cette sécurité et de ces stabilités durement acquises.
Sacrifice

Le major Hillary Jaeger, le sergent Danny Noyés et le caporal Phil Fewer de l'équipe chirurgicale de campagne du deuxième bataillon canadien soignent une victime d'un tir de mortier avant son transport à l'hôpital du camp Visoko.
Les Canadiens peuvent être fiers de la réputation de notre pays à travers le monde comme force de paix, mais cela a un prix. Environ 130 Canadiens sont morts au cours d'opérations internationales de soutien de la paix. Dans les Balkans, 23 de nos militaires ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés.
Les blessures du maintien de la paix ne sont pas toujours causées par des tirs ennemis, des mines terrestres ou des accidents. Parfois, les cicatrices du service sont psychologiques. Les efforts militaires du Canada dans les Balkans ont été particulièrement difficiles pour nos soldats. Les crimes de guerre et les atrocités commis contre la population civile y ont été horribles. Être témoin d'une telle brutalité humaine a souvent un impact profond sur ceux qui en sont témoins.
(Anciens Combattants Canada (ACC))
https://www.veterans.gc.ca/en/remembrance/wars-and-conflicts/caf-operations/balkans
